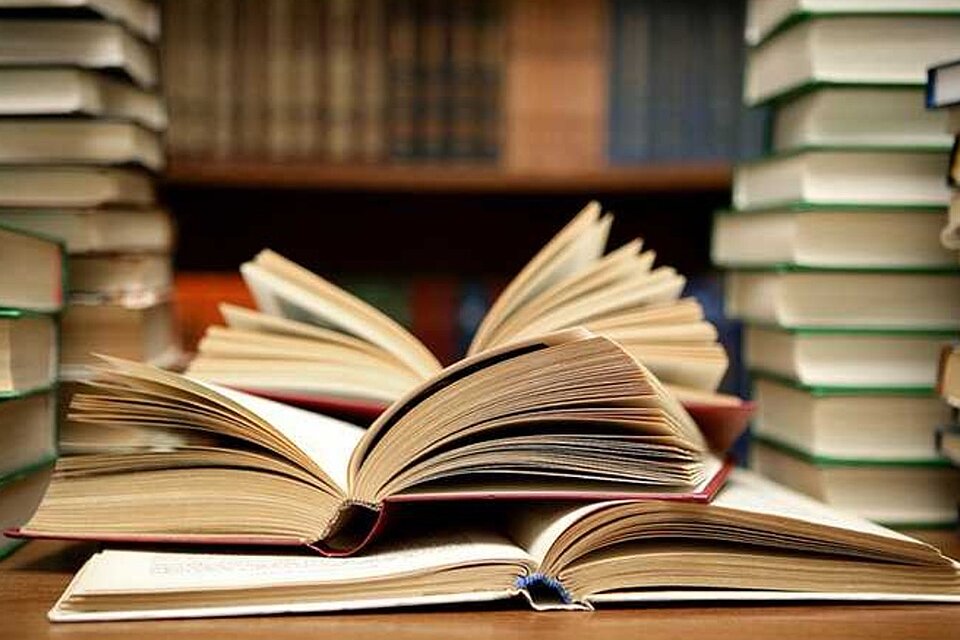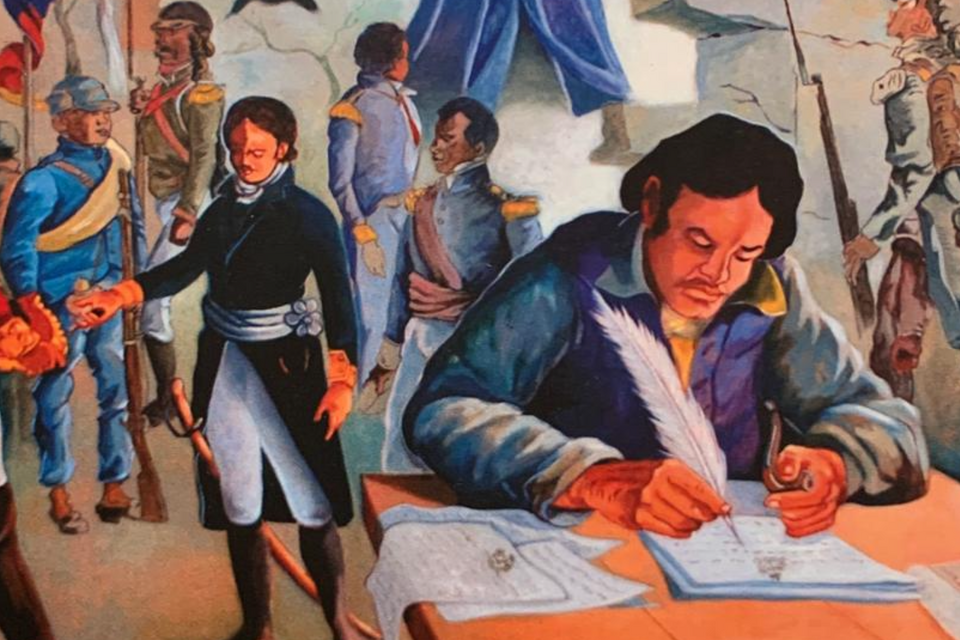L'économie haïtienne a longtemps été façonnée par des politiques néolibérales qui ont accentué les inégalités et freiné le développement local. Dans cet article, nous analysons l'échec de ces modèles économiques en examinant les conséquences des réformes initiées par Leslie Delatour et ses promoteurs. Nous mettons également en lumière la nécessité d’un changement de paradigme en faveur d’une croissance plus juste et viable, favorisant la production nationale et renforçant la souveraineté économique.
Tout plan ou projet économique viable et durable doit être inclusif, ouvert à diverses approches philosophiques et scientifiques, et encourager un débat contradictoire mais constructif. Nous estimons que "la politique du non-engagement politique" est une illusion trompeuse. Le néolibéralisme, ou économie de marché libre, a échoué et continuera d’échouer en Haïti. L’élite haïtienne ne doit pas se réfugier derrière des stratégies économiques défaillantes pour consolider son contrôle sur l’ordre social et politique, tout en monopolisant les richesses. Les économistes politiques de l’école de pensée implantée en Haïti par Leslie Delatour et ses disciples en sont un exemple frappant. Né en 1950, Delatour a étudié à l'Université Johns Hopkins et à l'Université de Chicago avant d’occuper des postes clés, notamment celui de ministre des Finances de 1986 à 1988 et de gouverneur de la Banque de la République d'Haïti de 1994 à 1998. Il a également été consultant pour la Banque mondiale, la Banque interaméricaine
de développement et l'USAID.Fervent défenseur des réformes néolibérales, il prônait la privatisation et la libéralisation économique. Toutefois, ces politiques ont été largement critiquées pour avoir affaibli l'économie haïtienne, notamment en inondant le marché de riz importé subventionné, ce qui a sous-évalué la production locale et nui aux agriculteurs haïtiens.
Comme l'a souligné un article de The Guardian en 2014 : "Haïti a souffert de décennies de dictature brutale et de politiques dictées par Washington qui ont aliéné les travailleurs, réduit les salaires et privatisé les services publics."
Il est essentiel de repenser notre approche économique afin de favoriser une croissance véritablement équitable et pérenne. Les modèles imposés de l’extérieur ont historiquement échoué, et il est temps d’adopter des stratégies qui valorisent la production nationale, renforcent la souveraineté économique et placent le bien-être des citoyens au cœur du développement.
Le Simonisme pourrait ainsi offrir une alternative viable en mettant en avant un modèle économique fondé sur l’intégration, l’investissement dans les infrastructures locales et la protection des secteurs productifs haïtiens.